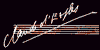|
|
 “Taugenichts” (bon à rien), c’est ce que pense le Pr Wieck (alias Dr Raro) de Robert Schumann, son ancien disciple qui s’est mis dans la tête d’épouser la jeune Clara, fille dudit professeur et petite pianiste prodige à qui Friedrich Wieck a inculqué l’essence — selon lui — de l’art pianistique, c’est-à-dire la maîtrise d’un mécanisme dont la fantaisie doit être bannie même si toutes les difficultés ne peuvent être résolues par les seules prouesses du doigté comme le reconnaîtra bientôt la jeune virtuose : “moins je joue en public ces temps-ci, plus je me mets à détester cette virtuosité mécanique” (Carnets de mariage de Robert et Clara Schumann, 15-08-1841). “Taugenichts”, selon le même Pr Wieck, que cet échappé d’une librairie provinciale de Zwickau (Saxe), nourri de poètes et de pommes de terre, buvant de la bière, fumant le cigare, portant le cheveu très long et courant la Rote Hanne (Jeanne la Rousse) et qui s’essaie à l’écriture sous le pseudonyme de “Robert de la Mulde”, hésite entre l’étude du droit et celle de la musique, balance entre la virtuosité de clavier et les affres de la composition : “Toute ma vie j’ai considéré la musique vocale comme au-dessous de la musique instrumentale et je ne l’ai jamais regardée comme du grand art”, affirmera Robert Schumann en 1839. Fin 1840, sous l’influence de Schubert, de Mendelssohn et surtout de Clara Wieck, il aura composé plus de 140 Lieder dont l’opus 39 sur des poèmes de Eichendorff (“la plus romantique de toutes mes musiques et qui contient beaucoup de toi”, avoue-t-il à Clara) et l’opus 48, sur des poèmes de Heine ; tout en ajoutant : “J’aimerais chanter moi-même à perdre haleine, comme un rossignol”, admettant ainsi, et roulades parlant, préférer les rossignols allemands aux canaris italiens (“oh, Clara, quel plaisir divin d’écrire des lieder ! Je m’en suis abstenu trop longtemps”). Un “Taugenichts” aussi sentimental que Sterne, vivant de l’imagination, se complaisant dans les larmes (Ich hab’ im Traum geweinet), aussi mélancolique que le Jaques de Shakespeare (Wehmut), aussi primesautièrement amoureux que l’Ecossais Rabby Burns (Die Rose, die Lilie, die Taube), aussi empêtré dans son dialecte saxon que Gurth, le gardien de porcs à l’écoute des devinettes du bouffon Wamba dans l’Ivanhoe de Walter Scott (auteur des mieux aimés de la jeune Clara) ; un “Taugenichts” qui affiche l’image de Napoléon sur les murs de sa chambre et insère des fragments de la Marseillaise dans son Carnaval de Vienne ou dans Die beiden Grenadiere, qui parcourt à pied le Tyrol, la Suisse, l’Italie (de Milan, où il entendra chanter la Pasta, jusqu’à Venise), qui admire les ruines gothiques, les cathédrales et le Rhin en sa majesté (Im Rhein, im heiligen Strome), qui ne songe qu’à rejoindre l’université de Heidelberg et sa “tonne” (Die alten bösen Lieder) où l’attend impatiemment son ami Gisbert Rosen, étudiant en droit à qui Schumann écrit le 5 juin 1828 : “Leipzig est une infâme bourgade dans laquelle on ne peut passer gaiement la vie” et aussi : “Peut-être, en ce moment, es-tu assis sur la montagne, dans les ruines du vieux château, adressant un sourire heureux à la floraison du mois de juin (Frühlingsnacht), tandis que moi, debout parmi les ruines des châteaux en Espagne que j’ai édifiés, je soupire, contemplant dans le ciel sombre le présent et l’avenir” (Zwielicht). “Taugenichts” encore, que ce grand jeune homme qui goûte les poètes romantiques, les Müller, Arnim, Jean-Paul Richter, Uhland, Schiller, les frères Grimm, Mörike, sinon Goethe, parce qu’ils lui rendent dans leurs récits tel Brentano et son Des Knaben Wunderhorn (le Cor merveilleux de l’Enfant) ou dans leurs chansons semi-populaires la meilleure part de son enfance retrouvée et cet esprit de la musique que la seule Clara saura apprivoiser (Und wüßten’s die Blumen, die kleinen), une Clara qui, pour l’instant, aime les cerises — elle appréciera plus tard les kloubnikou (fraises) de Moscou — les charades et les histoires de doubles, les robes bleues ou de velours noir, comme en Concert, les Alpes Saxonnes et leurs précipices, la campagne de Connewitz, la Valse de Weber, Paris, l’Ouverture du Don Juan de Mozart (“qui réussit si bien avec les moyens les plus simples, les plus modestes” ou encore : “cher Mozart ! comme il a dû aimer le monde, comme il réchauffe le cœur. Jamais je n’ai entendu quoi que ce soit de lui qui ne me mette de belle humeur et c’est ce qui doit échoir à tous ceux qui le comprennent.”) ; Clara qui, par-dessus tout, aime son piano (Graf, de Vienne) et ce “polisson” de Robert aux yeux bleus (“quand je me suis mise à aimer mon Robert tout au fond de mon être, alors, pour la première fois j’ai vraiment ressenti ce que j’étais en train de jouer”), allant même jusqu’à craindre de lui faire mal avec ses baisers (Carnets, 16-12-1840).
Clara qui ne pourra, en conséquence, qu’apprécier follement les Lieder de Robert Schumann, lieder qu’elle essaiera même — gage d’amour supplémentaire — de chanter en s’accompagnant elle-même pour leur rendre leur vraie raison d’être (“J’ai joué et chanté beaucoup des Lieder de Robert d’une manière très enjouée ... Quelle richesse d’imagination, quelle émotion profonde dans ces Lieder”, Carnets, 26-09-1840), ignorant délibérément de la sorte les Wilhelmine Schröder-Devrient, Elise List, Sophie Schloss, Henriette Sontag-Rossi (cet “antechrist musical” selon Robert Schumann et que Hector Berlioz, lui, compare à l’alouette aux portes du Paradis !), Jenny Lind (le Rossignol suédois) ou autres coqueluches de l’époque comme Pauline Garcia dont Clara n’apprécie que très modérément la “Gretchen” que Pauline donna un jour — accompagnée par d’autres — “davantage pour satisfaire l’attente du public, que au cœur de ce rayonnement intime si magnifiquement exprimé tant par les mots que par la musique de Schubert”.
“Taugenichts” si l’on veut, mais un “Taugenichts” semblable au héros de Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff (1788-1857), héros dans lequel Robert Schumann trouvait son double, le Frohe Wandersmann (Le Joyeux Voyageur) : “Taugenichts”, comme ces hommes de la campagne de Lubowicz-Ratibor (Haute Silésie) dont l’âme est en constante harmonie avec la sérénité des soirs qui tombent et de la lune qui monte au-dessus des champs ondulant à la brise (Mondnacht), ou des forêts bruissantes où caracole la “double” Lorelei (Waldesgespräch), en harmonie avec l’aube éternelle (l’alba des Troubadours ?) vers laquelle s’élance vertigineusement Die Lerche (l’alouette) loin au-dessus de l’Oder que Eichendorff traversa un jour à la nage ; l’alouette en place du rossignol nocturne qui susurre à Juliette (Intermezzo) le chant extatique d’une jeunesse qui, avec l’âge, va retomber au silence, oubliant à jamais cet enchantement temporel que la nature jette parfois sur ceux qui sont tombés sous son charme (Die Stille). “Taugenichts-Eichendorff”, fonctionnaire prussien de 1816 à 1844, chassé du château ancestral de Lubowicz (25 fenêtres ouvrant sur le parc) à la suite des revers de fortune de sa famille, en sera réduit à réunir des fonds pour mener à bonne fin les travaux d’achèvement de la Cathédrale de Cologne ou la restauration du château de Marienburg près de Dantzig, ancien siège du Grand Maître de l’Ordre teutonique, c’est-à-dire symbole de l’unité prussienne et de la culture allemande ; un “Taugenichts-Eichendorff” qui échappe ainsi au pittoresque gratuit et à ces teintures de compassion (les Wendes n’étaient-ils pas tisserands ?) appliquées à soi-même et que l’on retrouve si souvent dans les “Volkslieder” mais pas dans les “volkstümliche Lieder” (dont on connaît l’histoire semi-savante), et ce, du temps de la Silésie baroque et de ses châteaux qui rouillent comme l’armure du chevalier pétrifié de Auf einer Burg, évitant ainsi de tomber dans les chausse-trapes de la “Singvogel Natur” et de ses interminables roulades à l’italienne avant de se fondre dans un Romantisme de nouvel aloi, fait d’une succession d’impressions de lieux ou d’événements sur un esprit encore en harmonie avec eux. “Taugenichts” donc, que ce Robert Schumann — Don Quichotte de l’âme — fondant, en un métal sonore nouveau et en un style musical unique, Baroque et Romantisme (ce dernier mouvement qui passait au jugement de Goethe pour quelque chose de révolutionnaire et de malsain), en quête d’un Eldorado qui ressemblerait au chant populaire, à ce “quelque chose qui se meut de façon indescriptible, qui soudain sans transition visible se change en son exact contraire” (Im Walde), quelque chose à quoi le dilettante Heine souscrira également lorsqu’il essaiera de retrouver la relation organique perdue entre l’art et la vie ou s’efforcera de débusquer la vérité de l’homme derrière les masques de Carnaval ou d’Intermezzo. A Heinrich Heine, Apollon romain pour Théophile Gautier, Christ grec pour d’autres, certains dresseront une statue signée Hasselrijs, d’autres s’acharneront sur son image de pierre telle que l’avait voulue Elizabeth d’Autriche (Sissi) à Corfou et qui, de Hambourg à Toulon, Directeur des Folies Bergères intervenant, connaîtra bien des vicissitudes. La mère de Heinrich Heine parlait l’hébreu, le latin, le grec, tandis que lui-même apprenait les rudiments de la langue française avec Rataplan-Legrand, le Tambour de la Grande Armée (qu’un billet de logement avait jeté dans la famille Heine à Düsseldorf du temps de l’Occupation française) qui expliquait le mot “Liberté” en tambourinant la Marseillaise, le mot “Egalité” en battant le Ça ira et qui inculquera au jeune Heinrich le culte du “Grand Empereur” (ainsi le désignera Robert Schumann dans ses poèmes de Moscou) dont les “lèvres n’avaient qu’à siffler et la Prusse n’existait plus. Elles n’avaient qu’à siffler, ces lèvres, et le Vatican s’écroulait” ; tout cela à défaut de la politesse française, de la langue de La Fontaine, des boutiques du Quai Voltaire, de l’élégance des Parisiennes (petites cousettes — dont la grisette Mathilde — et lionnes illustres), des bonnes manières dans les Salons, synonymes d’égalité sociale (cette égalité que Robert et Clara Schumann ne devaient retrouver que sur le bateau les ramenant de leur périple russe) sans mentionner les auteurs à la mode du jour : les Dumas, Balzac, Gérard de Nerval, Sainte-Beuve, George Sand, Béranger ou les philosophes Hegel et Marx qui, toujours au nom de l’Egalité, fortifièrent son Saint-Simonisme, en sus des peintres Français qui lui montrèrent le chemin de la Liberté, comme Delacroix au Salon de 1831 dont la signature même monterait, paraît-il, à l’assaut de la Barricade.
En dépit de cette passion physique et intellectuelle que Henrich Heine vouera toujours à la France, il n’oubliera pas l’Allemagne, son “lointain amour” puisqu’il choisira comme épitaphe pour son tombeau au cimetière Montmartre où l’accompagnera Mathilde (Crescence Eugénie Mirat — 1815-1883 — qu’il avait épousée en 1841) : “Ici repose un poète allemand”. Dès 1856, la romancière anglaise George Eliot soulignait d’ailleurs l’évidence : “Lui et ses ancêtres ont dans leur jeunesse respiré l’air allemand ; ils ont été nourris de “Wurst und Sauerkraut” (saucisse et choucroute) de sorte que Heine est aussi allemand qu’un faisan est oiseau d’Angleterre ou qu’une pomme de terre est légume d’Irlande”. Heine, cependant, ne témoignait que bien imparfaite sympathie à l’endroit des Anglais et de leur langue “batracienne” car pour lui l’Angleterre reste l’île de Frankenstein (paradoxe si l’on se rappelle que Mary Shelley et son jeune étudiant créèrent leur monstre en Allemagne), l’île de Wellington “héros de cuir au cœur de bois et à la cervelle de papier mâché” ou celle du Dr Johnson “pot de bière ambulant”. Shakespeare seul trouvera grâces à ses yeux, peut-être parce que Roméo-Heine avait connu Juliette-Josepha à Hambourg, avant de tomber amoureux d’Amélie et de Thérèse, filles de son riche oncle Salomon qui le déshéritera pour mieux abandonner son neveu à ses frustrations d’adolescent pauvre incapable d’affronter les critères bourgeois qui régissent l’amour et le mariage et que Heine exprimera dans Das Buch der Lieder (Le livre des Chants), livre où bien des Allemands — dont Robert Schumann — se reconnaîtront. Heinrich Heine, des rivages de Nordeney, ramènera l’épique Nord-See tandis que Robert et Clara Schumann longeant les sables de la mer Baltique, ralliaient — de concert en concert — Petersbourg et Moscou (via la “Vagnera Sale” de Riga où s’illustrèrent Richard Wagner, Anton Rubinstein, Hector Berlioz, Franz Liszt et, plus récemment, Monsegur Vaillant) ; Moscou “la merveilleuse cité” et ses souvenirs napoléoniens et la cloche géante d’Iwan Welikii au Kremlin, avant de retrouver, au retour, dans leur “Allemagne chérie” (22 mai 1844) le carillon bien tempéré de l’église St-Thomas de Leipzig ou les cloches de la Marienkirche (entièrement restaurée, 1839-1842) de leur “cher Zwickau”, et, par la même occasion, cette “heilige Melancholie” (sainte mélancolie) qu’ils n’avaient su oublier sur les bords de la Moscova et que le compositeur avait déjà, et à jamais, emprisonnée dans la toile de ses émotions les plus diaphanes. “Aimer le peuple, oui, mais ne jamais l’embrasser”, conseillera Heine, car l’imagination du Poète, telle l’alouette d’Eichendorff, se rit des débâcles politico-idéologiques, des nationalismes de paroisse ou de la bigoterie religieuse telle qu’illustrée par le Frère José et le Rabbin Juda de Navarro ; l’imagination se gausse de la caste d’église comme de celle des guerriers telles que dans Almansor (ô Céline !) ignorant les joyeusetés intertextuelles car l’imagination vole, au-dessus du “chaos” pré-établi, vers l’unité de l’esprit à l’image de la Frühlingssymphonie (“Symphonie du printemps”, de Robert Schumann) ; unité qu’annonçaient déjà les bonheurs champêtres (Das ist ein Flöten und Geigen) des paysans du Don Juan de Mozart ou ceux des Fêtes de la moisson en “Lusatia”, une fois oubliés le désaccord des pirouettes verbales des “clowns” de Shakespeare ou les gastronomiques recettes de ce pasteur Poméranien : “Les paysans, comme la morue salée, il faut les battre pour les attendrir ...”
Désaccord que Robert Schumann fera sien, par avance : “Ne te révolte pas à la pensée qu’il y a tant de larmes dans la vie. Renies-tu les dissonances et les accords mineurs en musique, ne les aimes-tu pas ? Les unes et les autres nous apportent des voluptés célestes ...”, comme dit Gustav, porte-parole de Schumann dans un projet de roman datant des années 1825, faisant, par là-même, plus ou moins consciemment, écho au toujours éternel Don Juan de Mozart qui “dans le grand final du premier acte, lorsque les trois orchestres entrent l’un après l’autre, jouant chacun un morceau différent de caractère et de mesure qui se confondent symphoniquement, Mozart veut que le second et le troisième orchestres commencent leur partie en imitant des musiciens qui accordent leurs instruments, accordano. Cet effet est toujours négligé ou perdu”, comme le soulignera Louis Viardot dans son article : “Manuscrit autographe du Don Giovanni de Mozart, janvier 1856”. Unissant ainsi l’Hellène et le Nazaréen, Eusebius et Florestan, la Bien-Aimée lointaine et Chiara-Cherubino, “Taugenichts-Schumann”, tel le “Joyeux Voyageur” d’Eichendorff ou le vaillant meunier de Die schöne Müllerin (La Belle Meunière) de Schubert, ira jusqu’à Moscou, sinon plus tard jusqu’à Volgograd où l’on entend toujours sa Träumerei (Rêverie) même “à l’heure où les Empires se brisent” (Jer. li. 20) sans encore oublier Riga, via Sebezh à la frontière Russo-Livonienne (ô Jules Verne) où éclate soudain dans le corridor d’un train figé dans l’aube d’un matin de printemps (Im wunderschönen Monat Mai), un triomphant Widmung, manière d’offrande à tous ces “Taugenichts” partis à la conquête d’un monde qui leur échappe sans cesse (Allnächtlicht im Traume) et que — sans le savoir et clés musicales appropriées — ils ont déjà atteint au péril de leur raison “résonnante”, univers à des années-lumière (ô “Lichtpunkt” — point de lumière — ainsi Madame Schumann-mère appelait-elle son fils Robert) de ce soi-disant ordre d’un monde qui, dit-on, progresserait sans cesse vers le plus triomphant des bonheurs (Aus alten Märchen winkt es). “La postérité nous considérera comme un seul cœur, une seule âme”, écrivait Robert Schumann à Clara Wieck dans une lettre de 1838 (indépendamment de tous les Ich grolle nicht, de ce monde-ci), peut-être en cette manière de dialogue absolu, sinon d’identité indissoluble qui font l’incomparable valeur de ces Lieder intemporels, gemmes vocaux sertis dans leur écrin pianistique. Ne serait-ce pas là, la meilleure des “Dédicace” au Concert du 26 février 1992 à la Robert-Schumann-Haus de Zwickau ? Alors, comme on dit là-bas : “Glück auf !”.
CLAUDE D'ESPLAS - La Leçon de Musique |
ADG-Paris © 2005-2024 - Sitemap