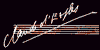|
|

Fremd bin ich eingezogen Tout compte fait, demeurera toujours l’éternelle question sur laquelle butent et buteront rhétoriciens et sophistes : où allons-nous ?, le poteau indicateur, Der Wegweiser, ne donnant que bien imparfaite réponse à cet éternel voyageur qu’est l’Homme parce que le poteau de la croisée des chemins fait partie intégrante du paysage, qu’il est symbole de sécurité, de durée, d’immutabilité des choses, même s’il n’indique que vaguement la direction d’un village ou d’une ville plus ou moins proche, que ce soit Vienne et son Hôpital Général, Prague ou la Bulgarie de Voltaire (“Candide marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel... Il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux sillons, la neige tombait à gros flocons...”) sinon la lointaine Constantinople et son Sultan Murat III à qui la reine Elisabeth I, en quête d’alliance avec le puissant Empire Ottoman, avait choisi d’envoyer “un cadeau aussi beau qu’original : un orgue à mécanisme d’horlogerie qui pouvait reproduire un roulement de tambour, sonner une fanfare ou jouer plusieurs airs de sa propre initiative”. Dallam, facteur d’orgues natif du Lancashire, était le vielleur de Sa Majesté... “Ta vielle accompagnerait-elle mon chant ?” (Der Leiermann) demandait Wilhelm Müller qui avait pleinement conscience que ses vers ne sauraient vraiment exister sans la musique, puisqu’il écrivit : “Je me console à l’idée qu’il se trouvera quelque jour un esprit semblable au mien, une âme sœur qui entendra la mélodie sous les mots et me la restituera” (Journal, 8 octobre 1815). Testament artistique au-quel Franz Schubert qui avait composé et chanté le Voyage d’Hiver devant un cercle d’amis frappés de stupeur, faisait écho : “j’aime ces mélodies plus que toutes les autres et vous aussi vous finirez par les aimer”. Trente ans après la mort de Schubert, Joseph von Spaun présent à cette “première” privée du Voyage d’Hiver, ajoutait : “Il est sûrement très vrai de dire qu’il n’y a pas de mélodies allemandes plus belles et elles furent son chant du cygne”.
Ce climat d’angoisse diffuse, ce sentiment de l’absurde, fruit de la contradiction entre ce besoin naturel de bonheur propre à l’Homme et la froide nature d’un monde indifférent, cette incertitude née d’une impression de quasi abandon mais qui n’a pas encore tourné à l’amertume ni conduit au rejet de toutes conventions sociales, cela existe déjà dans les Sieben und siebzig Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten(Soixante-dix-sept récits trouvés dans les papiers posthumes d’un corniste ambulant) de 1821, dédiés à Ludwig Tieck et contenant Die schöne Müllerin (La Belle Meunière), et encore dans ses Gedichten aus den hinterlaßenen Papieren eines reisenden Waldhornisten de 1824, dédiés à Carl Maria von Weber, “le maître immortel de la mélodie allemande”, où l’on trouve le texte intégral du Voyage d’Hiver tel que Schubert le découvrira en 1827. Wilhelm Müller, poète et érudit originaire de l’Allemagne du Nord, ne sut jamais que Schubert avait mis ses poèmes en musique, pas plus qu’il n’entendit le maître d’école-assistant (et compositeur !) chanter le Voyage d’Hiver d’une “voix légère”, vibrant d’émotion, transmuant ainsi le vil métal de l’expérience en or musical, en un fonds mélodique de lyrisme spontané tel qu’il baigne le bassin du Danube, les plaines de Hongrie ou qu’il enserre les sommets enneigés des Alpes autrichiennes, accompagné de ce poignant bonheur des sensations premières qui ne doit rien à l’âge, à l’expérience ou au carac-tère du compositeur (Erstarrung). “De belles mélodies allemandes” : c’était bien de cela en effet qu’il s’agissait puisque Müller, souvent considéré comme le prédécesseur de Heine, portait en gloire le Volkslied (Chant populaire) et la poésie de Goethe, savant mélange de vin, d’érotisme léger, de convivialité et de “chant allemand” ; Müller le philologue, lui-même membre de la “Société pour la défense de la langue allemande”, société qui mettait l’accent sur la continuité d’une “Poésie allemande” pour les seuls Allemands, eux qui, par ailleurs, s’intéressaient aussi aux travaux de la philologie romane (A.W. de Schlegel, 1818, Raynouard, Fauriel et d’autres encore) sur les Troubadours (et le Fin’ Amor) afin de mieux préserver les trésors d’une culture orale européenne en risque de disparition. “De belles mélodies allemandes”, dominées depuis les temps homériques par l’idée de l’errance et de l’errant éternels (Gute Nacht) : la vie n’est qu’un voyage régi par la Divine Providence à laquelle l’Homme doit se soumettre s’il veut éviter la catastrophe ; elle est vue comme cet ordre (public et privé) que nous trouvons au XVIIIe siècle dans la littérature d’almanac, dans la pastorale (Der Lindenbaum) et dans la légende de la société allemande de l’ère pré-industrielle avec le clinquant de ses cours, l’arrogance de sa noblesse, la timidité de sa bourgeoisie, la rusticité de sa paysannerie (Im Dorfe). Tout cela en prélude d’une manière de révolte ou d’une soif de liberté allant du siècle du raisonnement au siècle du comprendre avant d’ouvrir sur un monde nouveau qui verra le peuple créateur devenir à son tour le héros — ou anti-héros — tandis que, en Europe, la France perdra son hégémonie intellectuelle au profit de l’Allemagne. Si la musique, en son unique spécificité d’exprimer la volupté, se trouve à l’extrême opposé du langage (la poésie de Müller n’étant pas l’exception, bien que musique et langage s’adressent également à l’oreille), une volupté en toutes ses facettes émotionnelles, l’érotique n’en étant pas la moindre, si la musique se présente comme le plus abstrait des medias parce que d’autant plus éloignée de la dialectique temporelle (c’est-à-dire non soumise à l’historique), le Voyage d’Hiver porte en lui, lorsque l’on s’y attarde, l’écho d’une sensualité insidieuse ne serait-ce qu’au souvenir des amours malheureuses du compositeur (Die Wetterfahne).
Qui donc a vraiment été la “Bien-aimée lointaine” de Schubert ? Fut-elle Katharina von Làszny, ancien soprano du Kärnter Tor Theater de Vienne, ou Sophie Müller, qui chanta Die junge Nonne (la Jeune Nonne) le 3 Mars 1825 ; ou Pauline Anna Milder-Hauptmann (1785-1838) que le baryton Michael Vogl (1768-1840) et Franz Schubert allèrent voir à Hietzing et qui créa Erlkönig (le Roi des Aulnes) à Berlin ou Marie-Koschak Pachler (An Sylvia, D 891) ; fut-elle Anna Fröhlich — et ses élèves — qui donnèrent Ständchen à Döbling ou Karoline von Esterhàzy, fille du Comte Johann von Esterhàzy, à Zseliz, Hongrie ? Cette sensualité toujours présente dans le Voyage d’Hiver (Die Post) en dépit de ces appréhensions aussi fugitives que contemporaines qui laissent soupçonner que vivre à la surface de l’esprit enfermé dans un subconscient rationnel ne saurait constituer une défense sûre contre les forces à l’intérieur de notre propre nature (Die Krähe), face à un monde d’expérience visionnaire (mais non mystique) tel que préservé au cœur de toutes les traditions culturelles, dans les paradis ou sur les terres enchantées du folklore et de la religion, face à un au-deçà de fascinante illusion (Irrlicht), une sorte d’étrange sentiment “d’ailleurs” qu’on ne saurait appeler pessimisme ou misanthropie, cette sensualité qui attire et séduit ceux qui se cognent aux bornes de la personnalité quotidienne, on la pouvait déjà ressentir dans The Seasons (Les Saisons), poème de James Thomson (1700-1748), ouvrage qui fit époque en Angleterre, en Allemagne, en France et même en Russie (“Etendu sur son traîneau, le Russe emmitouflé de fourrures, va”), Thomson qui se voit lui-même comme “quelqu’un qui n’apprécie pas la saison d’allégresse et qui fuit la lumière aveuglante de l’été” autorisant ainsi Robert Burns, un demi-siècle plus tard, à implorer :
“Come Winter,
Laissant de côté les arrière-pensées ou les récentes découvertes de notre temps, les points sur les i et les barres sur les t, activités chères aux puristes, ou le repérage des caractéristiques techniques : choix des clés, sources extra musicales dans les paroles ou les influences (Beethoven, Haydn, Gluck, Mozart, Clementi, pour ne pas mentionner Walter Scott ou Goethe, fabricant de mélodies qui préféra Zelter à Schubert parce que Zelter transforme la musique en la presque servile servante de la poésie), le retour du balancier de l’histoire fera que l’on reviendra toujours de l’analyse et de la sèche analyse tout court, aux mouvements de l’âme au cœur des chefs-d’œuvre, loin de “l’irritant une-deux de la majeure partie de la mélodie allemande classique”, selon la formule de Kaikhosru Shapurji Sorabji (ô Josef von Spaun !) ; déclaration à laquelle Leopold von Sonnleithner avait déjà fait un sort : “Je l’ai entendu (Schubert) accompagner et répéter plus de cent de ses Lieder. Il avait, avant tout, l’habitude d’observer le plus strict tempo, sauf dans les rares cas où il avait noté de façon explicite les ritardando, morendo, accelerando, etc. De plus il ne permettait jamais que l’on forçât l’ex Si la musique constitue la “nourriture de l’amour”, comme le dit Shakespeare, Schubert, amoureux déçu et compositeur d’opéras frustré (cf. Alfonso und Estrella, 1821-1822, et l’air de Troïla qui resurgera dans Täuschung), Schubert, dans sa quête de l’amour pur, se tournera finalement vers la composition de Lieder au cours d’une lente progression (en rien comparable à celle du Pilgrim’s Progress — le Voyage du Pèlerin — de Bunyan) allant de taverne en taverne (Zum Schloß Eisenstadt, Dornbach, Zum Kaiserin von Österreich pas loin de Vienne, Zum roten Kreuz, Zum grünen Anker près de la cathédrale St-Stephan ou le Café Bogner, parmi d’autres) avant d’en arriver à l’ultime auberge (Wirtshaus), c’est-à-dire au cimetière de Währing dont les épitaphes “éternelles” s’efforcent de concilier les deux aspects de l’attitude face à la vie : une acceptation joyeuse et courageuse des possibilités offertes par le difficile parcours de l’existence (Mut!) et un désespoir spirituel aussi inéluctable que cruel.
Dans le Voyage d’Hiver les tragédies immémoriales de l’amour et de la mort revêtent une ex
“The city is built
CLAUDE D'ESPLAS - La Leçon de Musique |
ADG-Paris © 2005-2024 - Sitemap