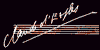|
|

‘Amami Alfredo, amami quant’io t’amo’: jamais pareil cri d’amour ne fouilla les entrailles des spectateurs d’un théâtre lyrique. Violetta court vers le jardin dans l’immense silence d’applaudissements qui ne viendront pas. Les yeux des femmes en bijoux brillent étrangement, les hommes retiennent leur souffle, la baguette du chef d’orchestre (qui a chanté à Vienne) reste en suspens, Alfredo se fige devant cette voix “argentée” en la définition de Jean-Jacques Rousseau, aux harmoniques qui mêlent sonorités du métal pur et timbre du plus fin cristal : “Addio ! ”... 28 mai 1955, Teatro alla Scala : la tragédienne grecque Maria Callas sort de scène sur ce même Addio, jeté de cette voix cuivrée striée de métal impur et des angoisses d’un passé proche, saluée par un ouragan d’enthousiasme (stipendiés de l’applaudissement inclus) comme seule en déchaîna la Bellincioni dont — selon Tomasi di Lampedusa, l’auteur du Gattopardo (Le Guépard) — il ne fallait pas “rater” le Amami, Alfredo. La formidable voix du baryton Germont emplit la salle de ses nappes de bronze (“Di Provenza il mar, il suol”) dont le timbre rayonne sur la Crau et la Camargue de Mirèio qui “tend au soleil d’or l’arc brun de ses sourcils”, sur les matadors et sur les zingarelles venues de loin et dont les ancêtres ont quitté la Valachie à l’appel du vent qui passe, allant de tchardas (auberges) en tchardas, accordant l’harmonie des troupeaux et les grelots des carroutzas, vendant leurs femmes ou leurs filles lorsqu’elles sont trop sages ou trop folles, non sans avoir, au passage, de leurs archets divisés comme pour un grandiose Prélude et sur des cadences de mazurques, dérobé le cœur d’un Franz Liszt ou celui de jeunes paysannes aux corsages échancrés qui entrent dans la ronde (hora) de ce pas rythmique qui fera plus tard la gloire des belles gymnastes ; et ce, en vue peut-être d’accomplir — juste retour des choses (ô Taven !) — la pénitence du Dieu dont le Vicaire les condamna à ne pas “dormir en lit pendant sept ans” parce qu’ils lisaient “ès mains des gens” (“D’ognuno sulla mano, leggiamo l’avvenire”) avant de retrouver, via le Valabrègue de Vincent, en l’église des Saintes Maries de la Mer, leur patronne Sarah, la servante des Trois Marie qui connurent le Seigneur Jésus. Car il y a, là-bas, entre Rhin et Danube, un peuple, parent du Nôtre et dont l’histoire se flatte d’avoir distingué Murat, petit paysan du Lot, futur maréchal et roi de Naples, un peuple qui vit dans un pays où l’hiver est très long, le printemps très court, l’été torride qui mûrit les vignes et les blés de la plaine infinie ondulant jusqu’à Baltsi et où la langue française est comme une seconde langue nationale, un peuple que Frédéric Mistral en la personne du plus grand de ses poètes, le Moldavien Vasile Alecsandri, saluait ainsi en son poème : A la Roumanìo (1890), “E t’appelant germano Les rouges escarbilles s’écrasent sur les vitres du compartiment tandis qu’on aperçoit dans la courbe infinie de la voie ferrée du côté de Turda, la noire locomotive qui troue la nuit de la Dacie trajane sous une lune couleur orange givrée (ô Norma !). Ce matin Violetta a quitté Bucarest et les bords de la Dombovitsa (“qui a bu de l’eau de la Dombovitsa, reviendra en boire ”, dit le proverbe) à l’orée de la rude et féérique traversée des Carpathes aux délicates dentelures que l’on pourrait croire découpées, du côté de Sinaïa, par quelque reine-poètesse, parfois flanquées de châteaux sûrement dressés pour séquestrer cette cantatrice dont le poignet s’ornait d’un bracelet de diamants gros comme des noisettes, présent du Tsar Alexandre II, cantatrice et Princesse lointaine que Jules Verne, secrétaire général de la Grande Boutique, rechercha vainement. Ces Carpathes bleutées sous le soleil de no-vembre qui vocalise sur les sommets des Bucegi, tels ceux de Linda di Chamounix, et dont les cimes sont plus étincelantes que les crêtes de Bagnères de Bigorre où Marguerite Gautier fortifiait ses convalescences de cœur et les vallées, plus tendres que celles de Cauterets où Giuseppe Verdi soignait ses maux de gorge et, à l’occasion, invitait Escudier à qui il avait signifié qu’‘‘ on ne doit pas tousser au dernier acte de La Traviata ’’ ; tandis que dans l’ambiance feutrée du wagon-restaurant, sauces piquantes et crêpes Suzette appellent quelque vin généreux ignoré de la guinguette du Point du jour à Bougival, devant les ondes tranquilles de la Seine profonde entre la plaine des Gabillons et l’île de Croissy (“Ah ! Ah ! scopriva Flora, il mio ritiro”) où l’on entend murmurer les saules, comme chante le cobzar :. “ La lune a passé sur les saules, “Que les Italiens sont heureux !”, s’exclamait Chabrier (Saint-Saëns nous le rapporte) en s’asseyant au piano pour chanter la phrase “Parigi, o cara” avec autant de passion qu’un Toscanini donnant la réplique à la voix acidulée de sa Violetta aseptisée des enregistrements New-Yorkais de 1946 (“Santa Madonna, orribile ! ... ”). Il est maintenant loin le Parigi du boulevard de la Madeleine, de la rue d’Antin, de la rue de Pro-vence, le Paris du Palais Garnier (“Miei cari, sedete, è al convito que s’apre ogni cor”) derrière lequel se presse la foule des acheteurs aux portes de Noël, à deux pas du théâtre Mogador où la toute petite Violetta fit ses débuts dans la Veuve Joyeuse (“non gradireste ora le danze”) avant d’affronter en cette église, à quelques lieues du Nonant-le-Pin qui vit Alphonsine Plessis faire son entrée dans le Demi-monde, et plus jeune que Clara Wieck, les douloureuses gammes de Frauenliebe und Leben, celles du Liebestraum de Franz Liszt qui sait parler aux femmes ou L’Invitation à la Valse de Weber jusqu’à ce fameux endroit en majeur qui ne l’arrêtait jamais, elle : ré, mi, ré, do, ré, fa, mi, ré ... ou encore — avec cette voix d’enfant qui montait jusqu’à ... Lui — la Prière de Gabriel Fauré, telle que plus tard, chantée en la Cathédrale Américaine de Paris. Loin est le Paris du Théâtre des Variétés qui devait accueillir en un étonnant Opéra Non Stop les voix françaises du siècle (“Tra voi, tra voi, sapro dividere, il tempo mio giocondo ...”) à courte distance du Gaumont Palace et du Pont Caulaincourt qui unit les âmes de Dumas et de son héroïne dont les évasions ne peuvent que déboucher sur le Boulevard de Clichy au milieu de ce Carnaval permanent et nocturne qui, du Moulin Rouge au Moulin de la Galette, dissipe, de ses fleurs artificielles, l’ennui des “Marguerites errantes” (“che far degg’io ! ... Gioire ! ...”) ; le Parigi des camélias de Madame Barjon, des marguerites du jardin de Croissy, du géranium (“Prendete questo fiore”) que Dumas fils offrit à Mélanie W., la véritable héroïne d’Antony pour la guérir de ses bouderies et à qui il donna une fois rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise ; le Parigi des roses sur le balcon de Maria Callas qui tirait les rideaux de son appartement du Trocadéro avant l’ultime finale de Amore e Morte (“Ah ! Gran Dio ! Morir si giovine ...”). C’est maintenant la gare ouatée de brume et de vapeur, les regards profonds des voyageurs venus du fond des steppes, les grandes avenues aux lumières rares balayées par un souffle glacial, la façade de l’Opéra roumain, les affiches aux couleurs bleues et rouges sur les panneaux et les colonnes, les répétitions, les musiciens debout pour voir qui est donc cette “voix”, la Presse, les observateurs blottis dans la pénombre de la salle, l’atelier des costumes où bourdonne une ruche d’habiles petites mains qui mettent aux mesures la somptueuse robe de Violetta comme l’eût fait Catherine Lebay, l’humble couturière bruxelloise que le créateur de Monte-Cristo avait dévoyée dans les bois de Meudon avant qu’elle ne devienne la mère de l’auteur de La Dame aux camélias (“Se una pudica vergine, Degli anni suoi sul fiore”), la foule qui a attendu “en toussant” l’ouverture des portes après avoir, trois semaines durant, assiégé le téléphone du Directeur en l’espoir de quelque fauteuil rendu et qui bruit maintenant de soie et qui étincelle de pierres précieuses dans ce spacieux hémisphère du théâtre d’où Alexandre Korda partit à la conquête du Tout Hollywood et dont les murs exposent les portraits des stars qui ont illustré l’Opéra Magyar depuis 1948. Dans sa loge, Violetta vêtue de la seule musique de Verdi ou presque, enfile sa somptueuse robe de taffetas noir aux rouges festons, au milieu des flashes des photographes, des questions des journalistes (“Accompaniamentul orchestrei este foarte important pentru mine ... Violeta e un rol dificil ...”) avant les ultimes vocalises (les ré bémol seront-ils de la Fête ?) là-haut dans le bureau solitaire et glacé du Directeur-écrivain. Le couloir qui va jusqu’au plateau, la foule qui gronde comme une mer devant le rideau et c’est déjà la fin du Prélude qui accélère les battements du cœur de Violetta, comme il a fait palpiter ceux des Ponselle, Muzio, Sills, Olivero ou autres Sembrich et Caniglia, sans compter celui de la Spezia que Paris dédaigna et dont Verdi attendait qu’elle révélât certains passages auxquels on ne pense pas et qui “pour tous seraient nouveaux”. En ces moments du finale de “Ah, fors’e lui”, Violetta sent passer comme l’ombre des grandes qui ont porté la robe-titre devant ce même public : les Zeani, Cotrubas, Varady et l’inoubliable Anna Rosza-Vassilyu, elles qui firent ou font les beaux soirs du Met ou de la Scala avec cette voix de soprano un peu rêche qui râcle le timbre en sortant ; aux flonflons de la Rachel de Giulini répondent ici les raciniens frissons d’une Sarah Bernhardt, ivre de ces vocalises d’adieu au bel canto (“come è scritto, come scritto” puisque Verdi, du moins Proust l’affirme, aurait donné à La Dame aux Camélias le style qui lui manquait dans l’œuvre de Dumas) dans le “Sempre libera”, cher à la libre Strepponi, adieux qui, aujourd’hui encore, font passer comme une lueur d’angoisse sur les prunelles fixes des grandes anciennes de la Casa Verdi ou d’ailleurs (ni la Freni de la Scala, ni la Sutherland de Gênes — ou était-ce à Parme ? — n’apporteront démenti !). Le matador Germont follement acclamé par la foule en délire va sortir de l’arène de Provenza ; mais, depuis la répétition de la veille, ce raccourci de Titan escaladant l’Olympe du chant, porte les marques d’un étrange “dite alla giovine”, lui qui, pourtant, aurait fait d’un Bastianini une doublure et relégué les autres tubeurs historico-lyriques au rang de souffleurs d’avant-scènes d’opéra ; ce “dite alla giovine” que le compositeur a transposé en mi bémol majeur, au complet insu, semble-t-il, de la pseudo-critique contemporaine qui s’obstine à s’extasier sur l’andante du 28 mai 1955 du Teatro alla Scala, ce “dite alla giovine”, suprême exemple de myopie auditive (nous pardonne Mademoiselle Kalogeropoulos dont les “contre-fa” dans Norma (!) faisaient l’admiration de ce berger de Saint-Remy en mal de hautes-contre !). Sous le déshabillé transparent de l’acte III, venu tout droit du Boulevard des Capucines et du Paris du Bœuf Gras sinon de la “blague”, les teintes diaphanes de l’“Addio del Passato” se mettent à la couleur du dor (le chagrin et le désir) de cet acte qui ne combla Verdi qu’au travers de la seule Nilsson, comtesse de Casa Miranda, parce que, de sa blonde voix de neige, elle avait osé intérioriser le rôle : “E strano !” (C’est étrange !) ... Le rideau est tombé, dans un immense silence. Soudain, comme sous la direction de quelque baguette invisible, le public se lève et applaudit : piano, alle-gro, piano, forte, fortissimo, longuement, longuement, frénétiquement, frénétiquement, à n’en plus finir, à en mourir, à n’en plus finir, à en mourir ... Le chef d’orchestre, le visage en pleurs et la main qui trem-ble, s’efforce de graver sa signature sur le Livre d’Or. Dans la loge de Violetta, le baryton tout pâle s’incline et dit merci ; le ténor brisé (“Un di felice ...”) essuie les perles de sueur qui roulent sur son torse nu. Dans la salle à manger du Grand Hôtel, au milieu des dîneurs et des masques du samedi soir, Violetta entre, escortée de la délicate corbeille de fleurs précieuses que Tutti e coro ont déposée à ses pieds lors du finale de l’Acte II ; l’orchestre attaque le Funiculi, funicula ... comme au San Carlo, comme à la Fenice. Violetta comprend et ne retient plus les larmes qui inondent son cœur. Claude d'Esplas (La Leçon de Musique) |
ADG-Paris © 2005-2024 - Sitemap