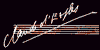|
|
 Lorsque le silence se fit avant les toutes premières mesures de l’ouverture de son opéra Der Bärenhauter, (l’homme à la peau d’ours), Siegfried Wagner – chef d’orchestre pour la circonstance – savait bien que le public parisien de la place du Châtelet était venu, dans le programme qui suivait : Le Crépuscule des Dieux, ouverture des Maîtres Chanteurs, écrite dans le petit hôtel du quai Voltaire (un nom cher aux habitués de Bayreuth), Le Vaisseau Fantôme (à jamais échoué sur les flancs de la colline de Meudon) ou l’hommage posthume de la Siegfried Idyll (au jeune homme qu’il faut bien souffrir d’avoir pour aïeul, comme dit le poète), mesurer le vol de l’aiglon à celui de l’aigle ; mais étrangement, à l’affiche de ce concert du printemps 1900 et au mépris de tout effort de conciliation de la part de celui dont le père avait, quarante ans auparavant, reçu l’accueil que l’on sait des pères de son public du Châtelet, ne figuraient ni Tannhäuser, ni Lohengrin. C’était le 13 mars 1861 : la première de Tannhäuser ; les partisans de la princesse Metternich et de la "Haute banque allemande" – comme on disait alors – allaient affronter la comtesse Walewska, femme de ministre, appuyée par la cour de Napoléon III et les abonnés de l’Opéra de Paris. Entre les deux camps, un guerrier mélomane, le Maréchal Magnan, habitué du Théâtre Italien où il avait entendu et apprécié des fragments de l’œuvre de Wagner. Le compositeur lui-même était là, et bien là, puisque depuis les répétitions, il avait réussi à se mettre à dos tous les chefs de service, exigé le renvoi du chef de claque, le célèbre M. David, demandé le remplacement du chef d’orchestre, M. Dietsch, et, selon Alphonse Royer, le malheureux directeur, trouvé un mot désagréable pour tout le monde, hormis peut-être cette parole de compassion à l’endroit de la jolie Mlle Sax poursuivie par un satyre-musicien échappé de ses bois : " Ne touche pas à Sax, ô faune ! ", ce qui ne devait pas arranger par la suite ses propres soirées avec l’orchestre… Le mot d’ordre émanait des membres du Jockey-club, puisque Wagner, en insérant sa "Bacchanale" au premier acte, refusait de travailler pour leurs lorgnettes. On installa donc les domestiques aux places les moins chères, on les munit de sifflets de chasse et de petits chiens à treize sous qui aboyaient quand on leur pressait l’abdomen, on racola des siffleurs de bonne volonté sous le péristyle du théâtre à qui on versa des … arrhes avant qu’ils ne missent deux doigts dans la bouche en manière de prélude ; on éleva quelques protestations pour la "Bacchanale" (les souverains étaient dans leur loge), on fit entendre quelques sifflets visant le duo Vénus-Tannhäuser qui n’en finissait pas, mais c’est le concours de ménestrels qui déchaîna la tempête. "Assez, assez !", hurlait une salle en délire, secouée de rires inextinguibles tandis qu’un loustic, profitant d’une accalmie, se mettait à siffler : "J’ai du bon tabac dans ma tabatière…" , scie immédiatement reprise par des chœurs dont la puissance ne le cédait qu’à l’improvisation. A l’odeur de brûlé qui, un instant, flotta dans l’air, répondit un cri : "C’est Wagner qui a mis le feu au théâtre", tandis que les grammairiens (il y en avait en ces temps !) conjuguaient à l’unisson et à tous les modes, le verbe : "Je Tannhäuse". La critique ne fut pas en reste : "Il est certain que si M. Wagner réussissait à verser aux Parisiens du Suresnes pour du Bordeaux, il pourrait espérer de leur servir plus tard du vinaigre et de le leur faire trouver excellent", écrivait Jouvin dans Le Figaro. Et Henri Rochefort de prophétiser : "Comment as-t-on osé mettre une meute de chiens dans un grand opéra ? Pourquoi non ? On savait bien qu’à la troisième représentation, il n’y aurait plus un chat dans la salle…" L’alchimie de Lohengrin ne supporta guère mieux les clameurs de ces patriotes qui empêchaient les représentations de l’Eden (le directeur Carvalho ayant refusé la pièce à l’Opéra-Comique) en interpellant directement le chef d’orchestre Lamoureux – Bordelais bon teint – à qui quelque probable admirateur de Rouget de Lisle enjoignait de chanter La Marseillaise, immédiatement soutenu par les "Vive la France !" de deux spectateurs du parterre en rupture d’apoplexie, le tout dans cette rare atmosphère de senteurs chimiques qui s’exhalait des tubes d’assafœtida ou de capsules de quintessence Richer. Au vu de ces inqualifiables soirées, s’étonnerait-on vraiment de ce que Wagner ait vilipendé les Français de 1879, ou méprisé le fard rose et la poudre de riz des Françaises (Judith Gautier devait lui apprendre par la suite qu’il n’est bon teint que de Paris), ces mêmes Français qui l’avaient laissé errer, famélique, à traquer le champignon égaré dans les bois de Meudon ou qui l’avaient expédié à pied à Bordeaux , muni d’une lettre scellée du directeur du Conservatoire, Chérubini ("Je vous envoie cet abominable raseur pour m’en débarrasser, débarrassez-vous à votre tour de lui comme vous voudrez"), à son confrère, le directeur du Grand Théâtre de Bordeaux. On s’étonnera bien davantage d’autres déclarations, plus tardives il est vrai : "On me suppose des rancunes parce qu’on m’a sifflé Tannhäuser ? Est-on bien sûr, d’abord, de l’avoir entendu tel qu’il est"? Aubert le savait, "le moment n’était pas encore venu de la musique sincère" , ou encore "les Français, ce n’est rien auprès de ce que m’ont infligé mes compatriotes en Allemagne, des cuistres qui se prennent au sérieux parce qu’ils ont le grade de docteur… Les âneries qu’ils écrivent , pour être rédigées en style philosophique, n’en sont pas moins des âneries…"; et Wagner d’ajouter, quinze ans plus tard : "Aujourd’hui encore, c’est de Paris que me viennent les appréciations les plus flatteuses et j’ai, qui plus est, l’assurance que, lorsque les Français joueront mes drames, aucun peuple ne les jouera comme eux." On sait encore l’admiration de Baudelaire, de Champfleury, de Schuré, de Villiers de l’Isle-Adam et de bien d’autres pour le compositeur de Tristan und Isolde, mais laissons à Catulle Mendès, qui avait bien pourtant sujet de se plaindre, le (presque) mot de la fin :"Je me borne à ne pas lui tendre les mains qui l’applaudissent." Mallarmé aura, lui, dans l’affaire Wagner, la plus décisive des influences et jusqu’à la fin, il restera un fervent de la musique wagnérienne. Dans les temps de liberté intellectuelle que lui laisse Janson de Sailly, le "misérable lycée lointain" (à quinze minutes de chez lui par le chemin de fer de petite ceinture, à quoi il faut ajouter cinq minutes à pied) et les autres établissements qu’il servit envers et contre l’inspection générale, contre les familles mal informées et en dépit d’un difficile état de santé ("trente ans, sans défaillance, il accomplit cette lourde tâche", constate amèrement sa fille Geneviève), Stéphane Mallarméfréquentera assidûment les concerts Lamoureux et Pasdeloup, collaborera avec Verlaine à "La Revue Wagnérienne", acclamera la noble attitude des Nerval, Banville, Villiers de l’Isle-Adam, Catulle Mendès, Judith Gautier partant en pèlerinage pour Bayreuth , parlera de l’Opéra de Garnier qui devait être inauguré le 5 janvier 1875 en insistant pour qu’un compositeur français soit affiché en cette occasion ou, à défaut, ajoute-t-il "on ne pourrait faire qu’une seule chose : prendre absolument le Tannhäuser et par un déploiement de gloire extraordinaire, le venger de l’outrage causé jadis au nom de la France par une centaine de malappris" ; le Poète ajoutant toutefois, courageux mais objectif : "solution plus impossible encore, depuis les armes, depuis l’Alsace, depuis le sang !". Mallarmé, traducteur d’Edgar Allan Poe, n’endossera-t-il pas, en sa personnelle chevauchée vers l’Eldorado, la livrée de Marasquin, de Miss Satin ou de Madame de Ponty, conseillant à ses lectrices le choix d’un corset au Bon Marché ; celle de Chef-de-Bouche de chez Brébant pour la gastronomie ou celle de Marliani, Tapissier-Décorateur, prince des Salons ; tous ces menus travaux d’aiguille qui l’aidèrent à acquérir un modeste voilier, peu comparable, bien sûr, à la Thétis (ou doit-on dire le Vaisseau Fantôme ?) qui, en juillet 1839, emmena Wagner de Norvège à Boulogne… Il fallait bien "alimenter les fourneaux du Grand Œuvre"!… En fait , la musique eût peut-être mieux répondu aux ambitions de Mallarmé que le langage puisque le Poète écrit dansDivagations : "La musique rejoint le vers pour former, depuis Wagner, la poésie" et encore "toute âme est une mélodie qu’il s’agit de renouer". La disposition typographique de Un coup de dés… ne ressemble-t-elle pas à celle des partitions musicales. Dernière analogie Wagner/ Mallarmé de ce dialogue "animus / anima" : les femmes. Elles auront pour nom Schrœder-Devrient, Minna Planner, Mathilde Maier, Jessie Laussot, Cosima Liszt, Judith Gautier, Marie, Méry Laurent ou Berthe Morisot dont le regard de feu évoque la toile de Manet l’immortelle Carmen de son voisin Bizet à Bougival ; ces inspiratrices ou égéries entourées d’une pléiade de beaux esprits ou d’artistes sans lesquels rien n’eût été possible : les Renoir, Degas, Monet, von Lenbach ou autres ; toutes à la fois et individuellement , en fin de compte et au bout de la quête, Kundry, Elsa, Elisabeth sinonIsolde… Commence ici une autre histoire.
CLAUDE D’ESPLAS |
ADG-Paris © 2005-2024 - Sitemap