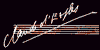|
|
 Arcachon, 1965. Tony Poncet confie à un journaliste de ses amis : "… aucun ténor que l’on classe parmi les plus grands, Mario del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, ne chante dans le ton (toujours un demi-ton ou un ton en-dessous de la partition)… C’est pour cela que je désirerais que l’on réunisse durant une semaine les dix meilleurs ténors italiens et je les prends un par un. Alors on verra bien celui qui chante et ceux qui vocalisent". A Vauvert, à Toulouse, en Belgique, à Lyon, Bordeaux, à Saint-Etienne, à Toulon ou à Cannes, on vous dira que Tony Poncet est le ténor le plus extraordinaire du monde. On ne vous expliquera pas que – à cause de lui – la note de passage supérieure, comme disent les "techniciens de la musique", est montée si haut dans le simple souci du ton original , que Caruso en personne y eût laissé ses registres. Des pays de la vigne aux terres du houblon, on ne vous citera pas tous ceux (ils sont tellement nombreux) qui, tel ce Major de l’armée Belge et ses quarante-trois Aïda, inhalèrent avec lui et par lui, l’éther duBel Canto. De la cathédrale de Bagnères d’où les vagues de voix des Quarante Chanteurs Montagnards d’Alfred Roland partirent à la conquête de l’Europe, aux humbles églises de campagne, on taira (qui ne l’a reconnu à l’instant du Minuit Chrétiens ou de l’Ave Maria mêlé aux purs accents de ceux qui débutèrent à ses côtés ?) le nom du Premier Soliste du Bédat… Son Voyage au Bout de la Nuit, Tony Poncet l’a, également, commencé Place Clichy, à deux pas des Studios Wacker, dans un grand café (que fréquentèrent les Munichois à l’époque où lui-même, à la manière de Dufilho, expérimentait en Bavière une communauté européenne d’avant la lettre). Il y détaillait Le Rêve Passe : il arrivait de la gare d’Austerlitz ; il chantait la Marseillaise avec cet accent descendu tout droit des pâturages de Bigorre que, entre la poire et le fromage, à défaut d’autres plateaux, lui reprochaient les divas de salon. Pourtant cet accent, ne le renièrent ni la petite bergère de Bartrès ni son Interlocutrice que Tony, toute sa vie, ferveur unique, salua en latin (il était polyglotte !). "C’était un pâtre", lançait un jour, condescendant, un ténor à la voix sans aigus. Il fut en effet, le berger des bergers, il fut "Arnold". Pâtre et "dalhayre" (faucheur), comme disent les connaisseurs sur les pentes herbues des montagnes Pyrénées où peinent les géants de la route, ceux qui, comme lui, démarrent dès les premiers lacets de Ste-Marie-de-Campan. Naturellement, il promenait sa tondeuse à gazon sur les pelouses de Listrac ou de St-Aigulin, mais il passait des heures à "piquer" sa faux à manche vert et aux parements rouges, seul, peut-être, à pouvoir encore le faire dans ces villages, aux confins de la Gascogne, qu’il avait, de cœur, élus. Evidemment, il astiquait son fusil "à lunette", mais Gaspard (de la S.P.A., Tarbes), son Pyrénéen miniature, n’a jamais débusqué un lapin (fut-ce en gibelotte) pour son maître, tireur d’élite, qui ne voyageait jamais (qui l’ignore ?) sans la petite valise noire, le colt et les "billes", souvenir du temps des appels et contre-appels (à défaut de rappels) au Stalag VII A et de son refus de chanter pour les Esthètes qui avaient fait taire le ténor Joseph Schmidt. Pour sûr, il menait la vie "à casse-cœur, à casse-cou" : mécanicien, chauffeur, conducteur de char,"bulldozer de l’opéra français", chef de chantier si vous voulez !, il allait vite. A portée de Dachau, les chars de Patton n’eurent pas à demander la clé : le tankiste Poncet connaissait la musique. Il leur donna la mesure. Les Américains se souviennent, qui lui conférèrent la Médaille de la Liberté "because we have not forgotten" (parce que nous n‘avons pas oublié). Sa dernière voiture fut une belle américano-allemande : il avait fait la paix !
Les femmes ? Comment ne les aurait-il pas aimées ? Madame Butterfly, il la rencontra à Tokyo, Micaëla à Bucarest. Il citait Beverly Sills ("Ah, quelle Reine de Navarre !") avec qui il chanta Les Huguenots à New York plutôt que Maria Callas qui préféra Di Stefano à ce "beau diable !" de Tony Poncet. Il vouait à ses partenaires féminines un respect vocal que ses aigus – l’eût-il choisi – auraient pu fort contrarier. Noblesse oblige ! Ce Don José, ce "Piaf" du lyrique, comme disait Germaine Lubin qui admirait la petite femme en noir de La Vie en Rose autant que le chanteur "italien" du Chevalier à la Rose, se plaisait, lui en la compagnie des grands toréadors, ses amis : El Cordobès, Cerdan, Albaladejo. Des arènes de Lutèce à celles de Nîmes, il estoqua pourtant plus d’Escamillos que de fauves. Il aimait le Pays Basque, le ciel de Pau, le rugby-champagne des Bagnérais, les contours du Bassin d’Arcachon ("rien jusqu’aux Amériques", d’où il était rentré plus Globe-Trotter que les enfants de Harlem après avoir "soulevé" les foules et refusé de servir de prête-voix à un Mario Lanza dans le film que ce dernier avait tourné face à la Tebaldi). Il aimait les pins des Landes, le rosé du Béarn, les gaves et leurs truites, les westerns où les méchants sont toujours punis ("encore faut-il tirer le premier !"), les films de guerre en version originale ("pour entretenir mon anglais") et les parties de boule sous les frondaisons de Capvern avec Fernandel et Brassens dont il appréciait le "Toute la vérité, messieurs, je vous la livre …" Fidèle à ses amis, les artisans de son enfance un peu buissonnière dont il lui était resté le goût du passage des frontières sans passeport ("exporté par l’adversaire, j’ai essayé de me réimporter, seul, sans imprésario"), les camarades de captivité, les machinistes de l’Opéra, Luis Mariano, qui lui procura ses premiers engagements, Fernand Raynaud, qu’à l’époque d’Opéra Non Stop, Tony Poncet cherchait en vain sur le planches de l’Opéra de Clermont-Ferrand, et qui, également proche du peuple, supportait mal les doreurs de pilule, les réputations surfaites, les faux naïfs – essayait-on de faire prendre un contre-ut pour un ré bécarre… ou (en dépit d’un bien mémorable Tournoi à Cannes) un roi Farouk pour un Radamès ("Pourquoi tu tousses ?"). Au critique qui lui reprochait d’être, dans son jeu scénique, "aussi démonstratif et pathétique qu’une bûche", répondra la simple réflexion de cette ouvreuse d’un Grand Théâtre de Province :"Je ne l’ai jamais vu entrer en scène dans Paillasse sans pouvoir retenir une larme", ou le rectificatif de Dominique Plessis aux propos d’un "Grand" du chant : "Tony Poncet a dix centimètres de moins, mais quand il chante il fait deux mètres". Modeste, notre ténor reconnaissait toutefois : "Caruso fait deux centimètres de plus que moi, mais il a deux notes d’aigu en moins". Le Troubadour Poncet était de ces bûches dont on fait les flammes. Cette voix du siècle, au legato d’airain (l’avez-vous entendu murmure Espaňa mia ou Te Quiéro ?), une Malibran lui eût tenu tête ; il eût fallu une Carmen pour courber ce Don José mais les gitanes il ne les aimait que "maïs", pour éviter la fumée. Lui dont la carrière gravita autour d’Austerlitz et de Wagram, à peine poussait-il la porte de quelque brasserie de la rue Legendre – où circulent pourtant de bien grand noms – que dix personnes le pressaient de leur accorder une signature en souvenir du temps où les chefs "tournaient leur mayonnaise" en attendant la fin des applaudissements qui accueillaient la phrase "ô Mathilde, idole de mon âme" dans un véritable délire. "C’est qu’il y avait là une ampleur de diction et d’organe qui subjuguaient l’auditeur et que ces admirables mélodies du grand maître italien rayonnaient d’une lumière nouvelle en passant par les notes de poitrine de cet organe merveilleux et par une déclamation d’une puissance inconnue" : ce sont les termes mêmes de Charles Gounod, qui avait entendu Duprez, saluant ainsi au passage le héros deGuillaume Tell. Invaincu, Tony Poncet est parti seul, dans l’habit d’Arnold, vers ce pays merveilleux, ce jardin fortuné, tel que dans l’Africaine, sa canadienne encore accrochée à droite dans le vestibule de la Maison Verte, son petit béret "oublié" rue de Rome chez la "Première Soprano de France" – en un suprême espoir sans doute - pour mieux chanter peut-être : "et ces soldats joyeux, Français, ce sont les nôtres !…".
CLAUDE D’ESPLAS |
ADG-Paris © 2005-2024 - Sitemap